Ress. humaines / Analyse
La pensée critique, une compétence clé du XXIe siècle
La pensée critique, une compétence clé du XXIe siècle
Internet, les réseaux sociaux puis l’intelligence artificielle (IA) ont fait du XXIe siècle celui de l’information. La question n’est pas de savoir s’il est possible d’obtenir une information, mais plutôt de savoir si l’information dont je dispose est vraisemblable et si je peux m’appuyer sur celle-ci afin de prendre une « bonne » décision… C’est pourquoi l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a reconnu l’esprit critique comme l’une des compétences clés de ce siècle.
____________________
Par Daniel Azarian (Ai. 199)
Publié le 2025-03-15
Par Daniel Azarian (Ai. 199)
Publié le 2025-03-15
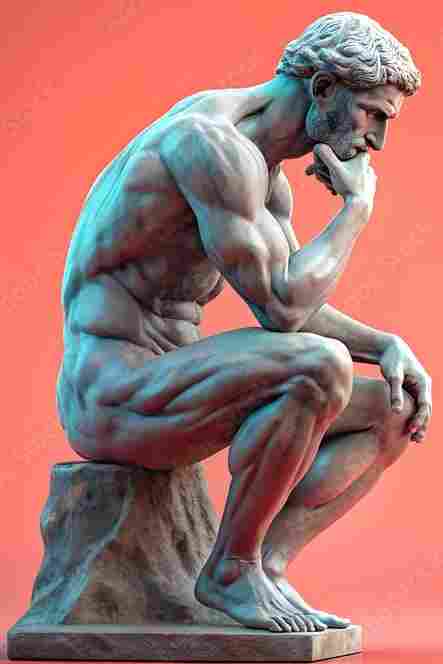 L’esprit ou la pensée critique désigne le mode de réflexion que l’on mobilise pour décider quoi croire ou faire, en essayant d’examiner nos propres jugements et croyances. Robert H. Ennis(1) la définit comme « une pensée raisonnable et réflexive orientée vers une décision quant à ce qu’il faut croire ou faire ». Cette définition, largement reconnue dans le domaine de l'éducation et de la psychologie, décrit la pensée critique comme un processus impliquant évaluation et raisonnement.
L’esprit ou la pensée critique désigne le mode de réflexion que l’on mobilise pour décider quoi croire ou faire, en essayant d’examiner nos propres jugements et croyances. Robert H. Ennis(1) la définit comme « une pensée raisonnable et réflexive orientée vers une décision quant à ce qu’il faut croire ou faire ». Cette définition, largement reconnue dans le domaine de l'éducation et de la psychologie, décrit la pensée critique comme un processus impliquant évaluation et raisonnement.Or, que nous agissions comme citoyen, salarié ou chef d’entreprise, nous devons en permanence faire des choix, c'est-à-dire décider. La pensée critique et ses outils visent à nous aider à choisir sur la base d’une analyse factuelle et rationnelle, la moins biaisée possible, nous laissant ainsi espérer trancher au mieux… que ce soit pour un acte anodin, comme acheter un article promotionnel mis en évidence par une enseigne de la grande distribution, ou pour une décision plus importante pour soi-même ou pour les autres, comme choisir une formation commerciale ou une politique de rémunération, organiser un poste de travail ou encore opter pour un traitement médical, une voie politique ou un choix sociétal.
IDENTIFIER « L’ARGUMENTUM AD POPULUM »
La pensée critique et ses outils permettent de choisir l’information la plus vraisemblable et la plus solide dans le registre des faits afin de prendre une décision majeure et impactante. Ils nous rendent également plus vigilants sur la façon dont nous interprétons ces faits lorsque nous passons dans la phase décisionnelle, en fonction de nos biais cognitifs et de nos jugements axiologiques (registre des valeurs), éthiques ou normatifs.
Plus largement et au-delà de son application pratique, la pensée critique tend à réfléchir sur notre mécanisme réflexif : on parle alors de « métacognition ». Il s’agit davantage de s’interroger sur le « pourquoi je crois ce que je crois » que sur la croyance elle-même. Autrement dit, je fais preuve de métacognition lorsque je deviens conscient du processus mental qui, par exemple, me pousse à croire qu’un produit « naturel » est meilleur qu’un produit « chimique ».
Ainsi, la connaissance et l’étude des biais cognitifs, dont les médias commencent à parler avec plus ou moins de pertinence, de même que la connaissance des arguments fallacieux constituent une facette de la pensée critique relative au développement d’une pratique argumentative. Dès lors, identifier un argumentum ad populum(2) ou une « pente glissante(3) » est une habitude saine ayant pour but de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques de nos interlocuteurs. Cette compréhension des biais cognitifs et arguments fallacieux nous conduit également à la vigilance quant à notre propre fonctionnement, nos propres arguments ou justifications. En effet, chacun de nous est notamment victime du biais de confirmation ou de la fâcheuse tendance à confondre corrélation et causalité. C’est ainsi que, en se fondant sur une étude scientifique révélant une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel obtenus par un pays(4), L’Express(5) conclut (trop) rapidement que manger du chocolat rend intelligent… C’est oublier un facteur dit « confondant », qui n’est autre que la richesse du pays. Ce n’est pas le chocolat qui rend intelligent, c’est la richesse d’un pays qui permet à ses habitants de faire des études et d’avoir la possibilité d’acheter une denrée chère comme le chocolat.
Plus largement et au-delà de son application pratique, la pensée critique tend à réfléchir sur notre mécanisme réflexif : on parle alors de « métacognition ». Il s’agit davantage de s’interroger sur le « pourquoi je crois ce que je crois » que sur la croyance elle-même. Autrement dit, je fais preuve de métacognition lorsque je deviens conscient du processus mental qui, par exemple, me pousse à croire qu’un produit « naturel » est meilleur qu’un produit « chimique ».
Ainsi, la connaissance et l’étude des biais cognitifs, dont les médias commencent à parler avec plus ou moins de pertinence, de même que la connaissance des arguments fallacieux constituent une facette de la pensée critique relative au développement d’une pratique argumentative. Dès lors, identifier un argumentum ad populum(2) ou une « pente glissante(3) » est une habitude saine ayant pour but de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques de nos interlocuteurs. Cette compréhension des biais cognitifs et arguments fallacieux nous conduit également à la vigilance quant à notre propre fonctionnement, nos propres arguments ou justifications. En effet, chacun de nous est notamment victime du biais de confirmation ou de la fâcheuse tendance à confondre corrélation et causalité. C’est ainsi que, en se fondant sur une étude scientifique révélant une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel obtenus par un pays(4), L’Express(5) conclut (trop) rapidement que manger du chocolat rend intelligent… C’est oublier un facteur dit « confondant », qui n’est autre que la richesse du pays. Ce n’est pas le chocolat qui rend intelligent, c’est la richesse d’un pays qui permet à ses habitants de faire des études et d’avoir la possibilité d’acheter une denrée chère comme le chocolat.
NE RIEN ACCEPTER SANS PREUVE
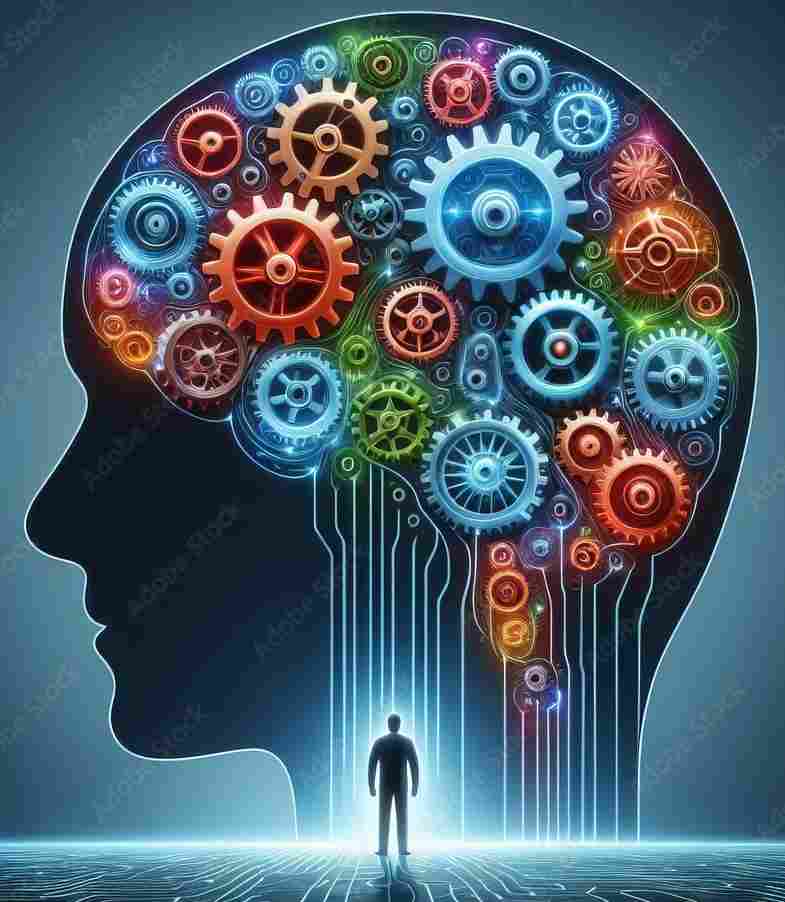 Un autre pan de la pensée critique se nourrit de la méthode scientifique et de la démarche expérimentale pour rechercher, sélectionner et vérifier les informations qui nous serviront à décider. Identifier les sources fiables d’information et connaître les niveaux de preuve (du simple bon sens qui nous ferait dire que le Soleil tourne autour de la Terre, à la méta-analyse d’essais comparatifs randomisés, summum de la preuve scientifique) sont notamment des compétences essentielles de la pensée critique nous permettant d’apprécier la pertinence et la solidité d’une affirmation. En effet, si la pensée critique n’est pas de douter de tout, c’est en revanche de ne rien accepter sans preuve. Si je vous disais qu’un dragon invisible crachant du feu habite mon garage, avant de me croire sur parole, vous me demanderiez quelques éléments de preuve face à cette affirmation. Ce que vous exigeriez légitimement de moi dans ce cas de figure devrait également être exigé, et ce, quel que soit le caractère extraordinaire ou non de l’affirmation(6).
Un autre pan de la pensée critique se nourrit de la méthode scientifique et de la démarche expérimentale pour rechercher, sélectionner et vérifier les informations qui nous serviront à décider. Identifier les sources fiables d’information et connaître les niveaux de preuve (du simple bon sens qui nous ferait dire que le Soleil tourne autour de la Terre, à la méta-analyse d’essais comparatifs randomisés, summum de la preuve scientifique) sont notamment des compétences essentielles de la pensée critique nous permettant d’apprécier la pertinence et la solidité d’une affirmation. En effet, si la pensée critique n’est pas de douter de tout, c’est en revanche de ne rien accepter sans preuve. Si je vous disais qu’un dragon invisible crachant du feu habite mon garage, avant de me croire sur parole, vous me demanderiez quelques éléments de preuve face à cette affirmation. Ce que vous exigeriez légitimement de moi dans ce cas de figure devrait également être exigé, et ce, quel que soit le caractère extraordinaire ou non de l’affirmation(6).Force est de constater que le monde de l’entreprise est depuis quelques années assailli par des idées à la mode(7), des méthodes et approches dites « différentes » que nombre d’organisations s’empressent de mettre en place sans s’être justement préoccupées des preuves relatives à leur efficacité, engageant ainsi argent et énergie sans être sûres que les résultats seront bien là. C’est ainsi que l’organisme de formation d’un grand réseau national de chefs d’entreprise propose un programme sur « l’intuition du dirigeant : un septième sens pour décider » qui promet « la clairvoyance » et « la prise de décisions appropriées » en s’ouvrant à « la réalité de l’instant ». Au-delà de la langue de bois, c’est ignorer les travaux plus que sérieux de Daniel Kahneman et Gary Klein montrant que, plus une décision est stratégique, moins l’intuition est bonne conseillère(8).
ÉVITER LES FONDATIONS CONSTRUITES SUR DU VENT
Au-delà même de l’inefficacité de ces méthodes, ces dernières peuvent parfois nuire aux individus ou aux groupes. L’essor du développement personnel dans le monde professionnel a notamment participé à l’arrivée en entreprise d’approches managériales, voire de philosophies d’entreprise fondées sur du vent, pire, sur des conceptions spirituelles, voire sectaires, conduisant à des risques de dérive largement documentés par la Miviludes(9).
Vous avez très certainement entendu parler du MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), ce test de personnalité qui affuble chaque année près de deux millions de personnes d’un acronyme à quatre lettres censé décrire la personnalité. Peut-être même l’avez-vous déjà passé ?
Rapportant près de vingt millions d’euros par an de recette à l’entreprise qui l’a inventé, ce test n’a pourtant pu passer sous les fourches caudines de la science psychométrique(10) et ne peut donc prétendre à une quelconque véracité… Et pourtant, malgré cette absence de preuves et les critiques récurrentes de la communauté scientifique, il fait fureur auprès des recruteurs, des coachs et des formateurs, constituant une manne financière pour ces derniers.
De même, vous avez tous eu droit aux éternelles références du cerveau droit et du cerveau gauche, des 10 % du cerveau que nous utiliserions ou des intelligences multiples, affirmations généralement faites à grand renfort de poncifs du type : « les neuroscientifiques disent… » ou bien « une étude précise que… ». Voilà de nouveau un sujet où la pensée critique peut être utile, car toutes ces affirmations relèvent du mythe… du neuromythe(11).
Si, en plus, ces neuromythes à la mode sont assaisonnés à la physique quantique, tout aussi fantasque et farfelue, vous aurez gagné le gros lot…
Pourtant, les offres de formations en ressources humaines qui font appel à ces concepts sont de plus en plus nombreuses, malgré les alertes de la communauté scientifique et des instances de lutte contre les dérives sectaires.
La pensée critique est donc un courant de pensée qui vise à apporter un peu plus de rationalité dans un monde qui voit la superstition et les affirmations fantastiques de plus en plus acceptées sans sourciller… Elle nous apprend à douter, mais pas de tout, et à ne rien accepter sans preuves solides !
Dans les épisodes à venir, nous creuserons des thèmes spécifiques qui touchent à l’entreprise au sens large du terme.
Daniel Azarian (Ai. 199)
 Daniel Azarian (Ai. 199)
Daniel Azarian (Ai. 199)
Membre de l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique (Astec), adhérent de l’Association française pour l’information scientifique (Afis), Daniel Azarian (Ai.199) intervient sur le thème de la pensée critique au sein du master 2 Communication et pouvoir, à la Sorbonne.
Vous avez très certainement entendu parler du MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), ce test de personnalité qui affuble chaque année près de deux millions de personnes d’un acronyme à quatre lettres censé décrire la personnalité. Peut-être même l’avez-vous déjà passé ?
Rapportant près de vingt millions d’euros par an de recette à l’entreprise qui l’a inventé, ce test n’a pourtant pu passer sous les fourches caudines de la science psychométrique(10) et ne peut donc prétendre à une quelconque véracité… Et pourtant, malgré cette absence de preuves et les critiques récurrentes de la communauté scientifique, il fait fureur auprès des recruteurs, des coachs et des formateurs, constituant une manne financière pour ces derniers.
De même, vous avez tous eu droit aux éternelles références du cerveau droit et du cerveau gauche, des 10 % du cerveau que nous utiliserions ou des intelligences multiples, affirmations généralement faites à grand renfort de poncifs du type : « les neuroscientifiques disent… » ou bien « une étude précise que… ». Voilà de nouveau un sujet où la pensée critique peut être utile, car toutes ces affirmations relèvent du mythe… du neuromythe(11).
Si, en plus, ces neuromythes à la mode sont assaisonnés à la physique quantique, tout aussi fantasque et farfelue, vous aurez gagné le gros lot…
Pourtant, les offres de formations en ressources humaines qui font appel à ces concepts sont de plus en plus nombreuses, malgré les alertes de la communauté scientifique et des instances de lutte contre les dérives sectaires.
La pensée critique est donc un courant de pensée qui vise à apporter un peu plus de rationalité dans un monde qui voit la superstition et les affirmations fantastiques de plus en plus acceptées sans sourciller… Elle nous apprend à douter, mais pas de tout, et à ne rien accepter sans preuves solides !
Dans les épisodes à venir, nous creuserons des thèmes spécifiques qui touchent à l’entreprise au sens large du terme.
Daniel Azarian (Ai. 199)
 Daniel Azarian (Ai. 199)
Daniel Azarian (Ai. 199)Membre de l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique (Astec), adhérent de l’Association française pour l’information scientifique (Afis), Daniel Azarian (Ai.199) intervient sur le thème de la pensée critique au sein du master 2 Communication et pouvoir, à la Sorbonne.
(1) Professeur émérite en philosophie de l'éducation, université de l’Illinois, États-Unis, auteur du livre de référence Critical Thinking (1987).
(2) Argumentum ad populum ou « appel à la popularité » est une tentative de gagner l’assentiment de son interlocuteur en faisant référence à la popularité d'une affirmation comme raison pour y adhérer.
(3) « Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates », Franz H. Messerli, M.D., The New England Journal of Medicine, vol. 367, no 16, 18 octobre 2012.
(4) « Manger du chocolat rapporte des prix Nobel », L’Express.fr, 15 octobre 2012.
(5) The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Carl Sagan, 1996, chap. 10.
(6) Consiste à affirmer, sans offrir la moindre preuve à l'appui, que poser un certain geste déclenchera une chaîne d'événements tous plus funestes les uns que les autres.
(7) Cf. Leadership, agilité, bonheur au travail… bullshit !, Christophe Genoud, éd. Vuibert, 2023.
(8) « Conditions for Intuitive Expertise: a Failure to Disagree », Daniel Kahneman et Gary Klein, American Psychologist, octobre 2009.
(9) Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Voir le dernier rapport d’activité annuel (2021) téléchargeable en version PDF sur le site www.miviludes.interieur.gouv.fr, rubrique « Documents utiles ».
(10) « Evaluating the Validity of Myers-Briggs Type Indicator Theory: A Teaching Tool and Window into Intuitive Psychology », Randy Stein et Alexander B. Swan, Social and Personality Psychology Compass, 25 janvier 2019. https://doi.org/10.1111/spc3.12434
« Measuring the MBTI... and Coming Up Short », David J. Pittenger, Journal of Career Planning & Employment, 1993.
(11) Voir les articles publiés dans Cortex Mag : www.cortex-mag.net/neuromythe-5-cerveau-droit-cerveau-gauche/ ; www.cortex-mag.net/en-finir-avec-les-neuromythes/ ; www.cortex-mag.net/neuromythe-n2-les-intelligences-multiples/ ((url non accessibles))
(2) Argumentum ad populum ou « appel à la popularité » est une tentative de gagner l’assentiment de son interlocuteur en faisant référence à la popularité d'une affirmation comme raison pour y adhérer.
(3) « Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates », Franz H. Messerli, M.D., The New England Journal of Medicine, vol. 367, no 16, 18 octobre 2012.
(4) « Manger du chocolat rapporte des prix Nobel », L’Express.fr, 15 octobre 2012.
(5) The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Carl Sagan, 1996, chap. 10.
(6) Consiste à affirmer, sans offrir la moindre preuve à l'appui, que poser un certain geste déclenchera une chaîne d'événements tous plus funestes les uns que les autres.
(7) Cf. Leadership, agilité, bonheur au travail… bullshit !, Christophe Genoud, éd. Vuibert, 2023.
(8) « Conditions for Intuitive Expertise: a Failure to Disagree », Daniel Kahneman et Gary Klein, American Psychologist, octobre 2009.
(9) Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Voir le dernier rapport d’activité annuel (2021) téléchargeable en version PDF sur le site www.miviludes.interieur.gouv.fr, rubrique « Documents utiles ».
(10) « Evaluating the Validity of Myers-Briggs Type Indicator Theory: A Teaching Tool and Window into Intuitive Psychology », Randy Stein et Alexander B. Swan, Social and Personality Psychology Compass, 25 janvier 2019. https://doi.org/10.1111/spc3.12434
« Measuring the MBTI... and Coming Up Short », David J. Pittenger, Journal of Career Planning & Employment, 1993.
(11) Voir les articles publiés dans Cortex Mag : www.cortex-mag.net/neuromythe-5-cerveau-droit-cerveau-gauche/ ; www.cortex-mag.net/en-finir-avec-les-neuromythes/ ; www.cortex-mag.net/neuromythe-n2-les-intelligences-multiples/ ((url non accessibles))
communauté Arts&Métiers
Société des ingénieurs A&M Arts & Métiers (ENSAM) Fondation Arts et Métiers Rexam Think Tank A&M Union des Élèves
