Technologie / Mécanique
Présentation de l’institut de biomécanique humaine Georges-Charpak
Présentation de l’institut de biomécanique humaine Georges-Charpak
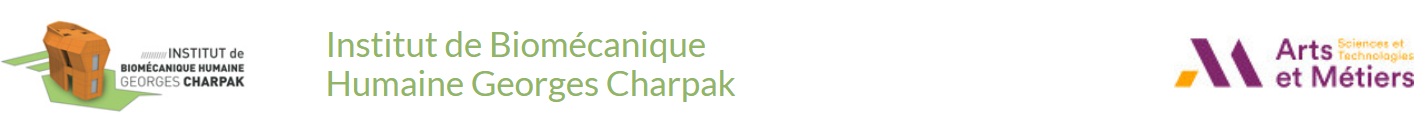 Dans le domaine de la biomécanique humaine, le développement de prothèses représente un défi scientifique et technique majeur. C’est un de ceux que cherche à relever l'institut de biomécanique humaine Georges-Charpak.
Dans le domaine de la biomécanique humaine, le développement de prothèses représente un défi scientifique et technique majeur. C’est un de ceux que cherche à relever l'institut de biomécanique humaine Georges-Charpak.____________________
Par Djamel Khames
Publié le 2025-02-07
Par Djamel Khames
Publié le 2025-02-07
L'anatomie complexe du pied, avec ses 27 os interconnectés, illustre la difficulté à reproduire artificiellement la marche humaine à l’aide d’une prothèse. Les fonctions d’une structure aussi dynamique impliquent de concevoir des solutions innovantes, comme des lames en carbone capables d’imiter les mouvements variés du pied sur des terrains divers : surfaces planes, pentes, escaliers ou encore sols irréguliers.
« Le lien entre recherche et application est justement un point fort de l'institut de biomécanique humaine Georges-Charpak. Qu’il s’agisse d’optimiser les performances d’un rugbyman en fonction de son poste ou de concevoir des prothèses adaptées à des handicaps uniques, la démarche reste similaire : comprendre les spécificités individuelles pour développer des solutions sur mesure », souligne Xavier Bonnet (Bo. 201), ingénieur d’étude chez Proteor et enseignant-chercheur à l’institut de biomécanique humaine Georges-Charpak.
Ce travail pluridisciplinaire associe biomécanique, ergonomie et ingénierie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Après des années de recherche, les progrès s’accélèrent. La transformation d’une preuve de concept en un produit commercial, bien qu'exigeante, démontre la capacité de l’équipe à traduire les découvertes en solutions concrètes.
La prothèse Synsys, récemment mise sur le marché, illustre cet aboutissement, intégrant des innovations issues des thèses de doctorat réalisées au laboratoire. Ce projet met en lumière l'importance des synergies au sein des équipes de recherche. Grâce à une collaboration efficace et continue, notamment avec les industriels, les chercheurs gagnent en rapidité et en précision, ce qui permet de réduire les délais entre innovation et mise en application. Le succès de ces travaux contribue non seulement à améliorer la vie des personnes amputées, mais aussi à repousser les limites des technologies biomécaniques. Une réussite à saluer, porteuse d’espoir pour l’avenir de la recherche appliquée en ingénierie biomécanique.
D.K.
« Le lien entre recherche et application est justement un point fort de l'institut de biomécanique humaine Georges-Charpak. Qu’il s’agisse d’optimiser les performances d’un rugbyman en fonction de son poste ou de concevoir des prothèses adaptées à des handicaps uniques, la démarche reste similaire : comprendre les spécificités individuelles pour développer des solutions sur mesure », souligne Xavier Bonnet (Bo. 201), ingénieur d’étude chez Proteor et enseignant-chercheur à l’institut de biomécanique humaine Georges-Charpak.
Ce travail pluridisciplinaire associe biomécanique, ergonomie et ingénierie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Après des années de recherche, les progrès s’accélèrent. La transformation d’une preuve de concept en un produit commercial, bien qu'exigeante, démontre la capacité de l’équipe à traduire les découvertes en solutions concrètes.
La prothèse Synsys, récemment mise sur le marché, illustre cet aboutissement, intégrant des innovations issues des thèses de doctorat réalisées au laboratoire. Ce projet met en lumière l'importance des synergies au sein des équipes de recherche. Grâce à une collaboration efficace et continue, notamment avec les industriels, les chercheurs gagnent en rapidité et en précision, ce qui permet de réduire les délais entre innovation et mise en application. Le succès de ces travaux contribue non seulement à améliorer la vie des personnes amputées, mais aussi à repousser les limites des technologies biomécaniques. Une réussite à saluer, porteuse d’espoir pour l’avenir de la recherche appliquée en ingénierie biomécanique.
D.K.
communauté Arts&Métiers
Société des ingénieurs A&M Arts & Métiers (ENSAM) Fondation Arts et Métiers Rexam Think Tank A&M Union des Élèves
